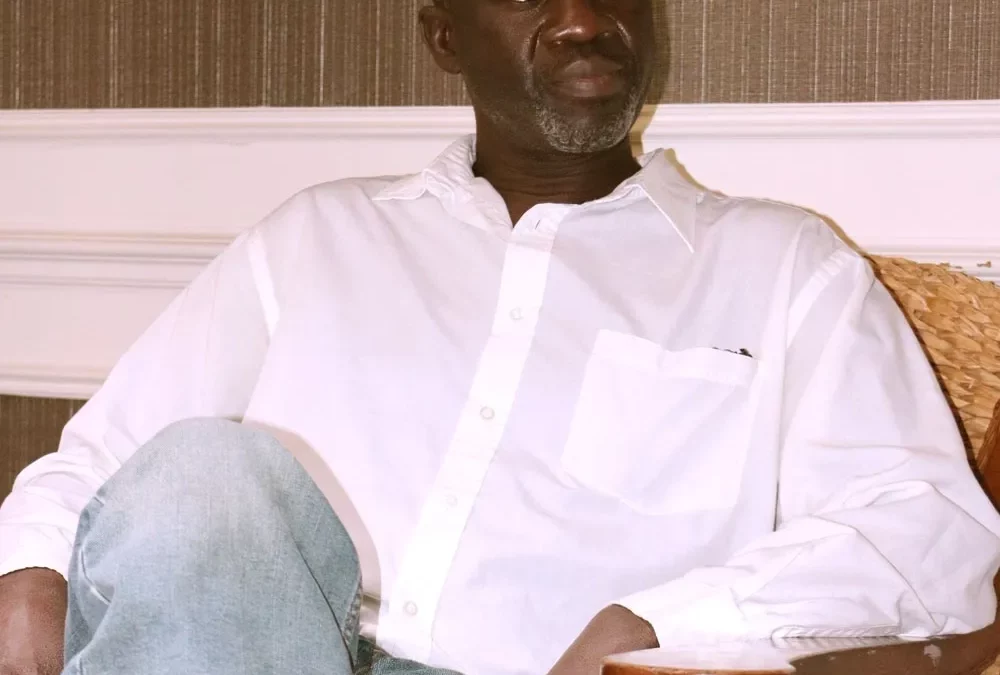Ce soir, alors que je suis installé au Canada vous le savez, du moins ceux qui me suivent et me lisent, loin de mes attaches premières, je reçois de mes partenaires du Sénégal un élément de la revue de presse du jour. Parmi les documents partagés figure la capture de la une du Point numéro 713 du lundi 25 août (voir photo ci-bas), où se trouve mis en lumière l’un de mes textes. Cette image, qui me parvient à travers les réseaux de veille d’outre-Atlantique, agit comme un fil reliant mes deux espaces de vie : le Sénégal, d’où émerge la matière brûlante de l’actualité, et le Canada, où je réfléchis à ses implications théoriques et stratégiques, au sein du think tank de Lachine Lab L’Auberge Numérique. Elle incarne parfaitement le rôle de la revue de presse dans notre monde moderne : faire circuler les récits, créer des ponts entre les contextes, et nourrir la décision à travers des horizons géographiques et politiques divers.
C’est à partir de cette expérience singulière, prise dans le temps immédiat et l’espace transnational, que je vais continuer l’examen de la place de la revue de presse dans la gestion stratégique des gouvernements et des organisations contemporaines. Rappelons, pour mémoire, que j’enseignais la sociologie de l’organisation intelligente et étendue à l’université d’Ottawa en 1998, tout en représentant le ministère des transports, de l’infrastructure et des collectivités au sein du Bureau des enjeux du cabinet du Premier ministre du Canada.
La revue de presse, souvent perçue comme un simple instrument de veille informationnelle, s’est imposée au fil du temps comme un pivot essentiel dans la gestion stratégique des gouvernements et des organisations modernes. Elle ne constitue pas uniquement un condensé de l’actualité, mais bien un outil sophistiqué d’interprétation, d’anticipation et de pilotage des enjeux. La publication d’aujourd’hui du Point numéro 713 et celle d’hier de DakarActu, mettant en exergue des réflexions sur le rôle de cet outil, offre une opportunité d’examiner sa place dans la fabrique contemporaine de la décision publique et organisationnelle. En effet, dans les économies informationnelles et exponentielles qui façonnent notre ère, la revue de presse devient la matrice silencieuse où se construisent non seulement les représentations du monde, mais aussi les trajectoires d’action des gouvernements, des think tanks et des élites de décision.
Historiquement, la revue de presse s’est développée comme un instrument d’aide au repérage de l’information pertinente. À l’époque où l’abondance médiatique n’avait pas encore atteint son seuil critique, elle permettait simplement aux décideurs de rester informés de l’essentiel. Mais l’entrée dans l’ère numérique, couplée à la multiplication des flux médiatiques et sociaux, a transformé ce dispositif en un outil d’intelligence stratégique. Aujourd’hui, elle ne se limite plus à une lecture sélective des journaux ; elle intègre les réseaux sociaux, les bases de données, les signaux faibles et les controverses en ligne, traduisant ainsi la complexité de l’opinion publique et des environnements concurrentiels.
L’état de l’art montre que les administrations modernes et les grands centres de réflexion ne se contentent pas d’agréger les informations : ils les traitent, les contextualisent et les mettent en perspective. La revue de presse devient un espace de construction d’un récit partagé, une matrice cognitive qui oriente les priorités politiques. Elle est ainsi articulée à la communication gouvernementale, à la gestion des crises, mais aussi à la conception des politiques publiques. Le rôle de la revue de presse est double : d’une part, elle sert de miroir, permettant au pouvoir de voir comment il est perçu, analysé ou critiqué ; d’autre part, elle agit comme un radar, en détectant les thèmes émergents susceptibles de devenir des enjeux cruciaux. Dans cette double fonction, elle devient incontournable pour la manufacture éclairée de la décision.
Les usages stratégiques connus sont multiples. Dans le champ politique, la revue de presse est une arme de conquête et de conservation du pouvoir. Elle permet de mesurer en temps réel l’impact d’une déclaration, de tester la résonance d’une réforme ou de calibrer la réponse à une controverse. Les gouvernements s’en servent pour anticiper les attaques de l’opposition, pour ajuster leur narratif et pour influencer l’opinion. Elle devient un instrument de cartographie de l’opinion publique et, par extension, un levier dans la construction des électorats. En effet, en repérant les lignes de fracture, les sensibilités sociales et les tendances de fond, la revue de presse nourrit les stratégies électorales et permet de segmenter les messages politiques en fonction des attentes citoyennes.
Sur le plan économique, la revue de presse est un outil d’intelligence organisationnelle. Dans un monde dominé par l’économie de l’attention et par la vitesse des innovations, les gouvernements et les think tanks s’en servent pour anticiper les mouvements de marché, suivre les stratégies des concurrents, et détecter les risques systémiques. Elle alimente la prise de décision en matière de politiques industrielles, énergétiques ou commerciales, en intégrant non seulement les analyses médiatiques, mais aussi les perceptions des acteurs économiques et financiers. Les stakeholders, qu’ils soient investisseurs, entrepreneurs ou partenaires institutionnels, scrutent ces signaux pour ajuster leurs comportements. Ainsi, la revue de presse devient un instrument de gouvernance économique, permettant d’articuler les politiques publiques avec les dynamiques de l’écosystème économique globalisé.
La dimension sociale de la revue de presse est tout aussi déterminante. Dans un monde où l’opinion est instantanément façonnée par les réseaux numériques, elle devient un instrument de cohésion ou de polarisation. Les gouvernements s’en servent pour détecter les colères sociales, pour anticiper les mouvements de contestation et pour orienter la communication publique telle que reproduit par l’article que je commente ici. Elle permet également de comprendre comment des sujets sensibles – immigration, environnement, santé publique, éducation – sont perçus, instrumentalisés ou mobilisés par différents groupes sociaux. En cela, elle ne se contente pas de rapporter des faits, mais elle donne des clés d’interprétation sur l’évolution du tissu social et sur les dynamiques de légitimation ou de délégitimation du pouvoir.
Dans la gestion des organisations contemporaines, la revue de presse occupe une place singulière car elle conjugue à la fois la rapidité de l’information et la profondeur de l’analyse. Les gouvernements, confrontés à la complexité croissante des enjeux globaux – crise climatique, guerres hybrides, transformations technologiques – ne peuvent plus se permettre d’improviser leurs décisions. La revue de presse, enrichie par des outils d’intelligence artificielle, par la data analyse et par la cartographie des controverses, devient un catalyseur de lucidité stratégique. Elle alimente les cabinets ministériels, les cellules de crise, mais aussi les grandes directions administratives, en leur fournissant un cadre interprétatif solide pour l’action.
Cette incontournable place de la revue de presse s’explique par la transformation des économies informationnelles en économies exponentielles. La rareté n’est plus l’information en tant que telle, mais la capacité à la traiter, à la hiérarchiser et à l’interpréter rapidement. Les organisations qui dominent la scène mondiale – qu’il s’agisse de gouvernements, de multinationales ou de think tanks – investissent massivement dans des dispositifs de veille et de revue de presse enrichie, car elles savent que la décision stratégique repose moins sur l’accès aux données que sur l’intelligence des récits qui en émergent. Dans ce sens, la revue de presse devient le lieu d’un travail d’ingénierie cognitive, où l’on transforme le bruit médiatique en signaux d’action.
Donc, on peut sans prétention exagérée dire que la revue de presse n’est pas un simple rituel bureaucratique, ni une routine journalistique internalisée par les administrations. Elle est un instrument de pouvoir, de gestion des enjeux et de construction du réel. Elle façonne les électorats, influence les citoyens et oriente les stakeholders, tout en permettant aux gouvernements de naviguer dans la complexité des mondes contemporains. À l’heure où l’information circule à la vitesse de la lumière et où chaque erreur de perception peut coûter cher, elle devient une boussole stratégique dans la gouvernance. L’analyse de ses usages révèle ainsi une évidence : loin d’être un vestige du passé, elle est l’un des dispositifs les plus modernes et les plus cruciaux pour piloter les sociétés dans l’ère des économies informationnelles et exponentielles.
Dr. Moussa SARR, post doc en ingénièrie de la connaissance.