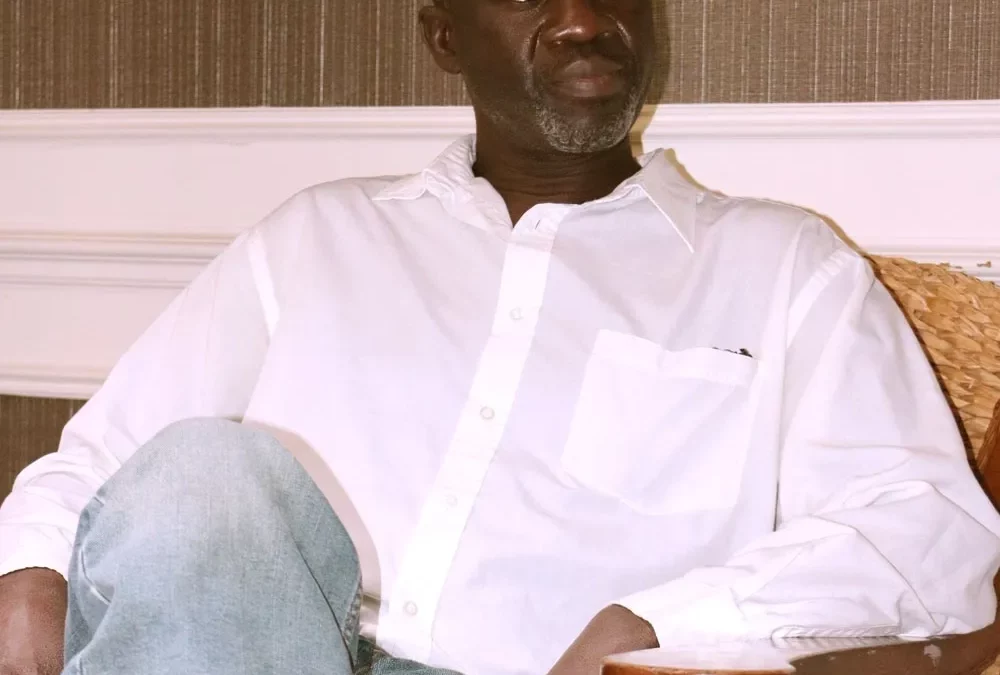Plaidoyer pour une économie anthropocénique au Sénégal en pensant et en agissant sous le signe de la convergence anticipatoire Par le Dr Moussa SARR
L’économie sénégalaise, comme celle de nombreux pays africains, a longtemps été pensée à travers le prisme du rattrapage. Le vocabulaire dominant dans les plans de développement depuis l’indépendance traduit ce tropisme : il fallait « combler le retard », « rejoindre le peloton », « s’arrimer aux économies développées ». Cette rhétorique du manque, nourrie par les comparaisons internationales et les indicateurs hérités de Bretton Woods, a produit une vision mutilée de l’avenir national. Elle a enfermé la trajectoire sénégalaise dans une dialectique du déficit permanent, comme si la mission historique du pays se résumait à courir après des modèles conçus ailleurs. Or, il est temps de rompre avec cette logique de dépendance symbolique et matérielle, et d’oser une réorientation conceptuelle et stratégique vers ce que l’on peut appeler une économie anthropocénique. Celle-ci n’est pas un simple ajustement technique. C’est une refondation ontologique qui place le Sénégal au centre de ses propres choix, en assumant le fait que l’ère de l’Anthropocène – cette époque géologique marquée par l’empreinte de l’homme sur la planète – impose une transformation radicale des modes de production, de consommation et d’organisation sociale. Le pari n’est pas de « rattraper » l’Occident, mais de s’inventer à l’aune des urgences planétaires et de la singularité culturelle nationale.
La théorie de la convergence anticipatoire (Sarr, 2025) offre une clé conceptuelle puissante pour penser cette mutation. Elle invite à ne pas se contenter de projeter linéairement les tendances actuelles vers l’avenir, mais à anticiper dès aujourd’hui les points de convergence entre défis globaux et potentialités locales. La convergence anticipatoire, en reprenant la formule de Pierre Teilhard de Chardin adaptée aux sciences sociales contemporaines, consiste à concevoir l’avenir non pas comme une addition d’événements subis, mais comme une œuvre collective sculptée dans le présent par des choix réfléchis. Elle suppose une ingénierie sociale et économique consciente, où les politiques publiques ne sont pas seulement réactives, mais intentionnellement configurées pour susciter des bifurcations positives. Appliquée au Sénégal, cette approche signifie que le pays doit s’inscrire dans une trajectoire qui embrasse à la fois les contraintes de l’Anthropocène – dérèglement climatique, raréfaction des ressources, transition énergétique – et ses propres ressources cognitives, culturelles et démographiques. Autrement dit, c’est un appel à la lucidité, mais aussi à la créativité stratégique.
L’agenda national de transformation – Horizon 2050 – fournit un cadre pertinent pour cette réflexion. Ce plan, pensé comme une projection à long terme, ambitionne de hisser le Sénégal au rang des économies émergentes et de consolider sa souveraineté. Mais si l’on applique le crible de la convergence anticipatoire, plusieurs inflexions s’imposent. Premièrement, il ne suffit pas de multiplier les infrastructures pour espérer le développement. Le risque d’une logique de rattrapage est de reproduire des modèles énergivores et inadaptés au contexte écologique. Une économie anthropocénique appelle au contraire à orienter les investissements vers des solutions basées sur les énergies renouvelables, la gestion intelligente de l’eau et des sols, et la circularité des ressources. L’enjeu n’est pas seulement technologique, il est épistémologique : il s’agit de repenser la valeur en intégrant dans le calcul économique le coût des externalités environnementales. Comme le rappelait Nicholas Georgescu-Roegen dans The Entropy Law and the Economic Process (1971), « une économie qui ignore la loi de l’entropie n’est qu’une illusion passagère ». Le Sénégal a l’opportunité historique de ne pas reproduire cette erreur, en inscrivant son agenda de 2050 dans une économie sobre, régénératrice et anticipatrice.
Deuxièmement, la démographie sénégalaise, souvent perçue comme un défi insurmontable, peut devenir un atout décisif si elle est pensée sous le prisme de la convergence anticipatoire. La jeunesse du pays, loin d’être un poids, constitue une ressource cognitive et créative inestimable. Encore faut-il transformer ce potentiel en capital effectif. Cela suppose une ingénierie sociale audacieuse : refondre le système éducatif en l’alignant non pas sur des modèles de reproduction coloniale, mais sur des compétences anticipant les mutations de l’économie mondiale. L’école sénégalaise de 2050 doit être une école de la complexité, formant à la fois des artisans de la sobriété énergétique, des ingénieurs du numérique éthique et des cultivateurs d’un savoir enraciné dans les humanités africaines. Edgar Morin l’a souligné : « L’éducation du futur doit affronter les incertitudes, développer l’aptitude à contextualiser, à globaliser et à anticiper » (Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur, 1999). C’est précisément cette logique qu’exige une économie anthropocénique.
Troisièmement, l’économie anthropocénique implique de redéfinir la place de la culture et de l’identité dans le processus économique. L’erreur historique des politiques de rattrapage a été de considérer la culture comme un supplément d’âme, un ornement secondaire par rapport à l’économie dite « réelle ». Or, dans un monde où les identités collectives deviennent des leviers de résilience et d’innovation, la culture est une infrastructure immatérielle aussi vitale qu’un barrage ou une autoroute. Le Sénégal, avec son héritage soufi, ses dynamiques artistiques et sa créativité diasporique, possède un gisement symbolique qui peut être mis au service d’une économie post-croissance. Cheikh Anta Diop, dans Nations nègres et culture (1954), rappelait déjà que « la renaissance africaine ne peut être que culturelle, avant d’être économique et politique ». Une convergence anticipatoire digne de ce nom doit donc articuler l’identité culturelle avec les exigences planétaires, en transformant la singularité sénégalaise en ressource de projection.
Quatrièmement, il faut prendre au sérieux l’idée que la politique économique est inséparable d’une ingénierie sociale. Dans un monde marqué par la complexité, les décisions économiques ne peuvent plus se limiter à des agrégats macroéconomiques. Elles doivent intégrer la fabrique sociale, les inégalités de genre, les fractures territoriales et les imaginaires collectifs. Une économie anthropocénique au Sénégal ne sera crédible que si elle parvient à inclure les populations rurales dans la transition, en valorisant les savoirs endogènes sur la gestion de la terre et de l’eau. La convergence anticipatoire commande d’anticiper les tensions entre urbanisation accélérée et désertification, entre besoins énergétiques croissants et rareté des ressources. Cela suppose un État stratège, mais aussi une société civile dotée d’une capacité d’innovation. L’ingénierie sociale consiste à concevoir des dispositifs participatifs, à stimuler l’intelligence collective et à créer des espaces de dialogue entre scientifiques, décideurs et citoyens.
Enfin, le pari d’une économie anthropocénique doit être évalué à l’aune des gains anticipés à l’horizon 2050. Quels bénéfices le Sénégal peut-il espérer en adoptant cette approche ? Le premier gain est celui de la résilience : une économie anticipatrice est moins vulnérable aux chocs climatiques, financiers ou géopolitiques. Le deuxième gain est celui de la souveraineté : en s’émancipant des logiques de dépendance technologique et énergétique, le pays renforce sa capacité d’autodétermination. Le troisième gain est celui de l’attractivité : dans un monde en quête de modèles alternatifs, le Sénégal peut devenir un laboratoire d’expérimentation reconnu. Enfin, le quatrième gain est celui de la dignité : en refusant la posture humiliante du rattrapage (social me too product), le pays affirme sa capacité à tracer sa propre voie, fidèle à son histoire et ouverte sur l’avenir. Comme l’écrivait Thomas De Koninck dans La dignité humaine (1995), « il n’y a de véritable développement que celui qui sauvegarde et promeut la dignité de la personne humaine ». C’est ce principe qui doit orienter la mutation anthropocénique.
Finalement pour mieux respecter l’économie de la communautique et faciliter l’interaction avec les internautes, le plaidoyer pour une économie anthropocénique au Sénégal est une invitation à rompre avec le mimétisme développementaliste et à embrasser une logique de convergence anticipatoire. C’est une exigence scientifique, car elle repose sur une lecture rigoureuse des contraintes de l’Anthropocène. C’est une exigence politique, car elle implique des choix courageux en matière d’éducation, d’énergie et de gouvernance. C’est une exigence éthique, car elle place la dignité humaine au cœur du projet. Et c’est, surtout, une exigence d’action immédiate : le futur n’attendra pas 2050 pour se décider. L’économie anthropocénique est déjà en germe dans les choix d’aujourd’hui. Au Sénégal de les assumer pleinement, afin que son horizon 2050 ne soit pas une promesse vaine, mais l’accomplissement d’une anticipation lucide et créative.
Note sur l’auteur
Dr. Moussa Sarr (Moise Sarr) est le concepteur de la théorie de la convergence anticipatoire, qu’il développe comme cadre épistémologique pour penser les mutations sociales, économiques et politiques dans l’ère de l’Anthropocène. Inspiré par la Law of Accelerating Returns de Ray Kurzweil et par les travaux prospectifs de Peter Diamandis (Abundance, Bold), il inscrit son approche dans le sillage des penseurs de la complexité et des accélérations technologiques. Sa réflexion a également été nourrie par l’intuition fondatrice de Paul Crutzen et Eugene Stoermer, qui ont proposé le concept d’Anthropocène pour désigner l’impact irréversible des activités humaines sur la Terre. Enfin, l’auteur revendique une filiation intellectuelle avec Bruno Latour, dont les analyses sur la « politique de la nature » et la remise en cause des frontières modernes entre science et société ont profondément influencé sa posture scientifique.